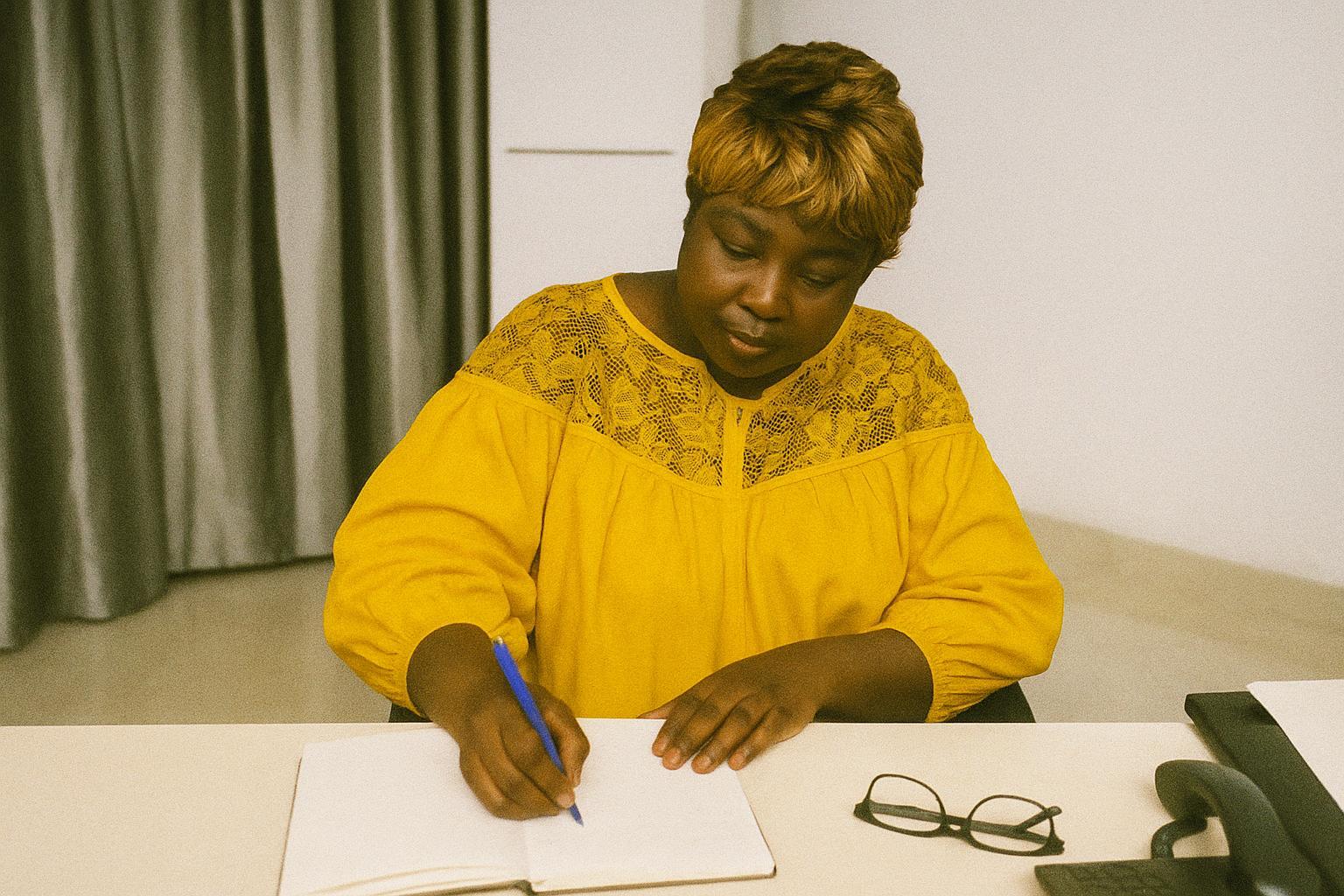Un cadre légal en constante évolution
Au cœur de la vaste couverture végétale du Congo-Brazzaville, le Code forestier, révisé en 2020, demeure la boussole institutionnelle supposée guider un secteur crucial pour l’économie nationale. Ce texte, salué par plusieurs partenaires techniques pour son alignement progressif sur les standards internationaux de gestion durable, stipule qu’aucune exploitation industrielle ne peut se poursuivre sans convention d’aménagement et de transformation dûment validée. Or, la coexistence de conventions arrivées à terme et d’autorisations provisoires témoigne de la difficulté à faire correspondre le rythme de l’administration à celui des opérateurs privés.
La note de la société civile : entre alertes et propositions
Rendue publique le 27 juin 2025 par Nina Cynthia Kiyindou Yombo, directrice exécutive de l’Observatoire congolais des droits de l’homme, la note de position de plusieurs organisations citoyennes met en exergue ce qu’elles considèrent comme un « vide juridique ». Cinq entreprises forestières – SPIEX, CDWI, SEFYD, SIFCO et SICOFOR – sont citées pour avoir poursuivi leurs activités sur la base de titres provisoires délivrés entre 2022 et 2024, après expiration de leurs conventions signées dans les années 2000. Selon les auteurs du document, l’absence de nouveaux cahiers des charges minorerait les bénéfices attendus pour les communautés riveraines et compliquerait la traçabilité du bois sur le marché international.
La position de l’administration : continuité du service public et sécurisation des emplois
Interrogé par nos soins, un haut cadre du ministère de l’Économie forestière explique que la délivrance d’autorisations transitoires vise à « éviter une cessation brutale d’activité préjudiciable aux milliers d’emplois directs et indirects liés au secteur ». Il souligne que ces mesures conservatoires s’inscrivent dans un calendrier de renégociation des conventions, lequel nécessite des études environnementales et socio-économiques approfondies. « La responsabilité de l’État est de concilier impératifs de conformité juridique et stabilité de la filière », insiste-t-il, rappelant que des missions conjointes administration-société civile sont déjà programmées pour le second semestre 2025.
Enjeux socio-économiques et attentes des populations locales
Dans les départements de la Sangha et de la Cuvette, les populations autochtones interrogées expriment un sentiment ambivalent. Si l’activité forestière reste pourvoyeur de revenus et d’infrastructures — écoles, dispensaires, pistes rurales —, elle suscite également des inquiétudes quant au partage équitable de la rente et à la protection des terroirs coutumiers. « Nous espérons que la renégociation des contrats intégrera des clauses claires sur le développement communautaire », confie un représentant d’une association villageoise, rappelant le principe de consentement libre, préalable et éclairé reconnu par les normes internationales.
Un marché international plus exigeant
L’enjeu dépasse les frontières nationales. Les importateurs européens et asiatiques renforcent leurs dispositifs de diligence raisonnée, exigeant des garanties de légalité et de durabilité. Toute ambiguïté sur l’origine des volumes exportés pourrait se traduire par des barrières non tarifaires, affectant la contribution du bois à la balance commerciale congolaise. À Brazzaville, les autorités disent mesurer ces risques et réaffirment leur volonté de finaliser, dans les meilleurs délais, le processus d’adhésion volontaire au schéma FLEGT, qui certifie la légalité des produits forestiers.
Vers une gouvernance forestière concertée
Face aux critiques, le gouvernement congolais réactive, depuis le début de l’année, divers espaces de dialogue multipartite. Un groupe de travail technique, associant administration, entreprises, organisations citoyennes et bailleurs de fonds, planche sur des scénarios de transition. Parmi les pistes à l’étude figurent la création d’un registre électronique des titres, le renforcement des missions de contrôle in situ et l’harmonisation des cahiers des charges avec les plans de développement locaux. Ce cadre consultatif, encore perfectible, illustre néanmoins la volonté d’inscrire la gouvernance forestière dans une démarche de transparence et de responsabilité partagée.
Équilibre délicat entre souveraineté économique et impératif écologique
Dans un contexte où la diversification économique demeure un objectif stratégique, le bois représente près de 6 % du produit intérieur brut congolais et plus de 10 000 emplois directs. Les autorités entendent donc sécuriser cette manne tout en préservant la réputation environnementale du pays, souvent présenté comme un « puits de carbone majeur » de la planète. La consolidation du cadre réglementaire, l’accélération de la transformation locale du bois et la redistribution des marges au bénéfice des collectivités apparaissent comme les clefs d’un compromis durable.
Perspectives : de la controverse à la réforme
Au-delà des divergences d’appréciation, la polémique sur les titres forestiers provisoires a au moins le mérite de rappeler l’importance du contrôle citoyen dans la saine gestion des ressources naturelles. Elle met également en lumière les avancées déjà réalisées par l’État congolais, notamment la modernisation progressive du cadre légal et l’ouverture d’espaces de concertation inédits. La feuille de route est désormais claire : évaluer les conventions arrivées à échéance, régulariser les autorisations transitoires et accélérer la mise en place d’outils de transparence, afin de garantir à la fois la compétitivité du secteur et la crédibilité internationale du pays.