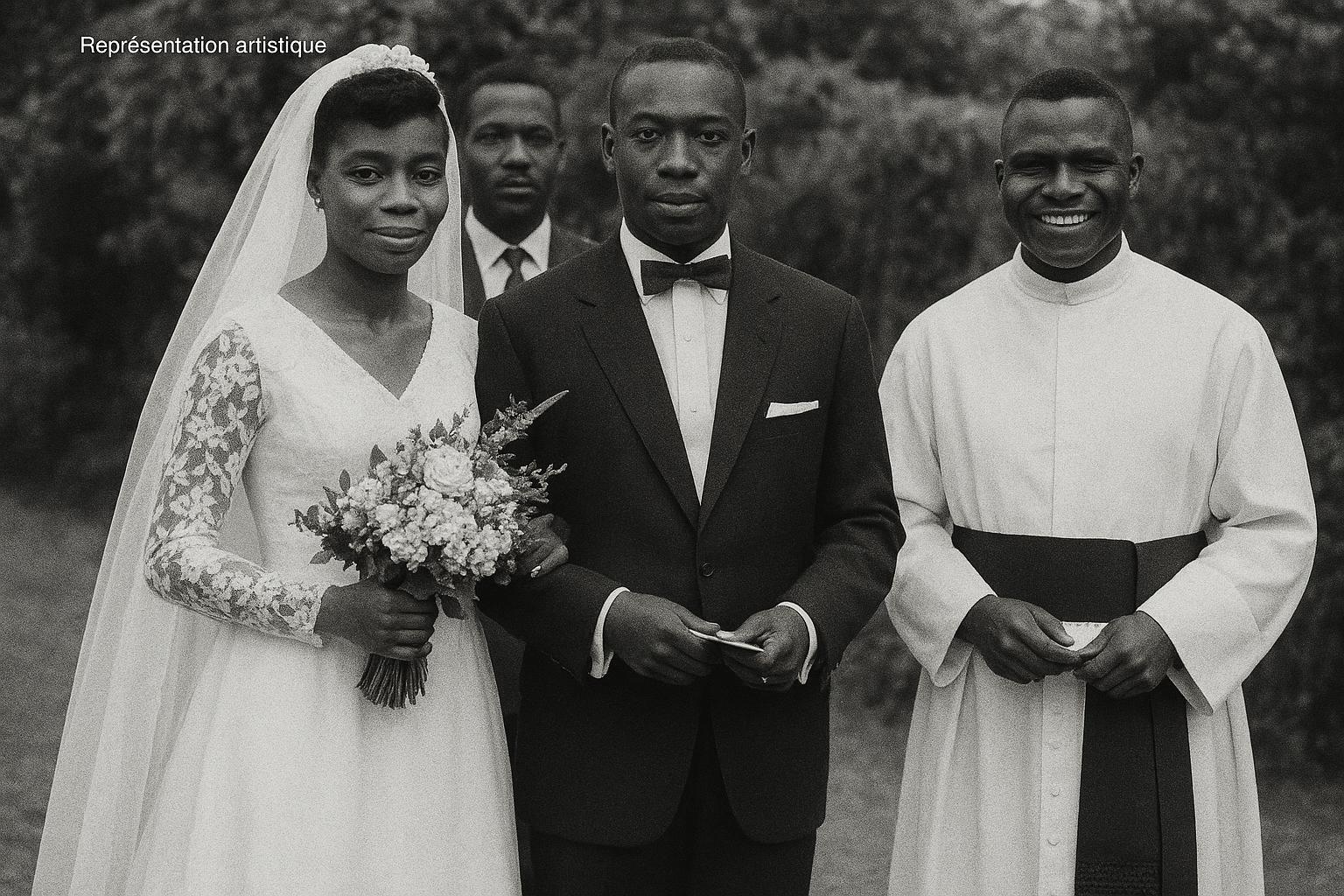Une enfance du Pool à la chaire parisienne
Né en 1935 à Kinkala, au cœur de la vallée du Pool, Martial Sinda grandit dans un environnement où la transmission orale des généalogies demeure fondamentale. Très tôt fasciné par la dimension spirituelle des sociétés kongo, il obtient à Brazzaville un baccalauréat classique avant de rejoindre la métropole pour des études d’histoire comparée des religions. Ses travaux à la Sorbonne, couronnés par une thèse sur les mouvements prophétiques d’Afrique équatoriale, le placent rapidement parmi les pionniers d’une lecture endogène des faits religieux africains, à rebours des grilles exogènes alors dominantes. Devenu maître de conférences puis professeur, il alterne séjours à Paris I et enseignements à Dakar, Abidjan et Kinshasa, convaincu que la circulation des savoirs nourrit l’émancipation intellectuelle du continent.
Parallèlement, il publie des essais denses, aujourd’hui considérés comme incontournables : « Simon Kimbangu et le martyre congolais », « André Matsoua, fondateur du mouvement de libération du Congo » ou encore son recueil poétique « Chant de départ », lauréat en 1955 du Grand prix littéraire d’Afrique équatoriale française. Ces textes, nourris d’archives et d’entretiens, articulent critique historique et sensibilité littéraire, donnant chair aux figures messianiques qui ont irrigué la conscience nationale.
Témoin privilégié des premières indépendances
Martial Sinda débarque à Brazzaville en 1958, au moment où l’abbé Fulbert Youlou, alors maire de la capitale, catalyse les aspirations autonomistes. Dans la parenté matrilinéaire kongo, l’abbé le considère comme son neveu, d’où une proximité affective qui n’altère toutefois pas la lucidité du chercheur. À rebours de l’engagement partisan, Sinda privilégie un rôle de médiateur. C’est lui qui présente Bernard Kolélas à l’abbé Youlou, puis qui tente, sans cesser de prôner la retenue, de dissiper les malentendus entre les deux hommes. « Je ne voulais pas que l’histoire se confonde avec la chronique », confiera-t-il plus tard (entretiens familiaux).
Cette position d’observateur engagé mais jamais inféodé lui vaut une estime transpartisane. Lorsqu’il évoque la « nécessité d’associer indépendance politique et souveraineté épistémologique », il anticipe déjà les débats contemporains sur la décolonisation des savoirs. Ses cours publics dans la salle des fêtes de Poto-Poto, souvent bondée, participent à diffuser une éthique de responsabilité collective au moment où le jeune État forge ses institutions.
Entre distance académique et retour sur la scène publique
Après deux décennies d’enseignement à l’étranger, le professeur réapparaît au premier plan lors de la Conférence nationale souveraine de 1991. Animé par la volonté de restituer la pensée sociale de Fulbert Youlou, il réactive le récépissé de l’Union démocratique pour la défense des intérêts africains (UDDIA), formation congolaise affiliée historiquement au Rassemblement démocratique africain. Ce geste, bien plus symbolique qu’électoral, se veut un plaidoyer pour la pluralité mémorielle dans un moment de refondation politique. « Je n’ai jamais trahi », dira-t-il à un proche, revendiquant une fidélité non pas à une personne, mais à « l’architecture morale » de la première République.
Si l’UDDIA peine à renaître dans un paysage partisan en recomposition rapide, Sinda n’en poursuit pas moins sa mission de passeur. Conférences, colloques et articles dans les revues spécialisées du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur lui permettent de mettre en garde contre « l’oubli volontaire » qui menace les jeunes générations. Ses interventions s’inscrivent, sans confrontation, dans le sillage des orientations nationales en faveur de la préservation du patrimoine culturel et de l’intégration sous-régionale.
L’héritage scientifique et civique d’un messager
À sa disparition, le 20 juillet 2025, la communauté académique salue unanimement la rigueur méthodologique d’un homme qui aura documenté les logiques du messianisme congolais bien avant que le terme ne rejoigne la vulgate panafricaniste. Ses archives personnelles, qui regroupent tapuscrits inédits, correspondances et enregistrements, sont en cours de classement. Elles intéressent tout autant les chercheurs que les responsables institutionnels chargés de la mise en valeur des anciens parcours de résistance.
Dans un contexte où Brazzaville multiplie les initiatives de coopération culturelle avec ses partenaires régionaux et internationaux, la figure de Sinda offre un point d’ancrage précieux. Son insistance sur le dialogue entre orthodoxie scientifique et engagement citoyen rejoint les priorités actuelles des politiques publiques de la République du Congo, soucieuses de concilier stabilité, mémoire et ouverture. Plusieurs universitaires suggèrent déjà de créer une chaire « Histoire des religions et dynamiques du prophétisme en Afrique centrale » qui porterait son nom.
La pérennité d’une pensée panafricaine
Le parcours de Martial Sinda démontre qu’il est possible de conjuguer exigence académique et sens aigu du service public sans se laisser happer par les turbulences partisanes. Son appel précoce à l’unité africaine, articulé autour d’une renaissance culturelle, résonne avec les chantiers continentaux du Marché unique africain et de la Zone de libre-échange. En rappelant que la souveraineté se nourrit d’imagination et d’action, il lègue enfin aux élites congolaises un devoir de transmission : mettre la recherche historique au cœur de la construction nationale.
Souhaitons que ce legs, loin de demeurer lettre morte, inspire les décideurs, les diplomates et les jeunes chercheurs qui, aujourd’hui, œuvrent à l’horizon 2030 d’un Congo plus inclusif et plus rayonnant. Car, comme l’écrivait le poète Sinda dans ses « Cantilènes de l’aurore », « aucune nation ne s’élève sans se souvenir de la sève qui l’a portée ». Brazzaville, en honorant son sage discret, éclaire ainsi sa propre trajectoire.