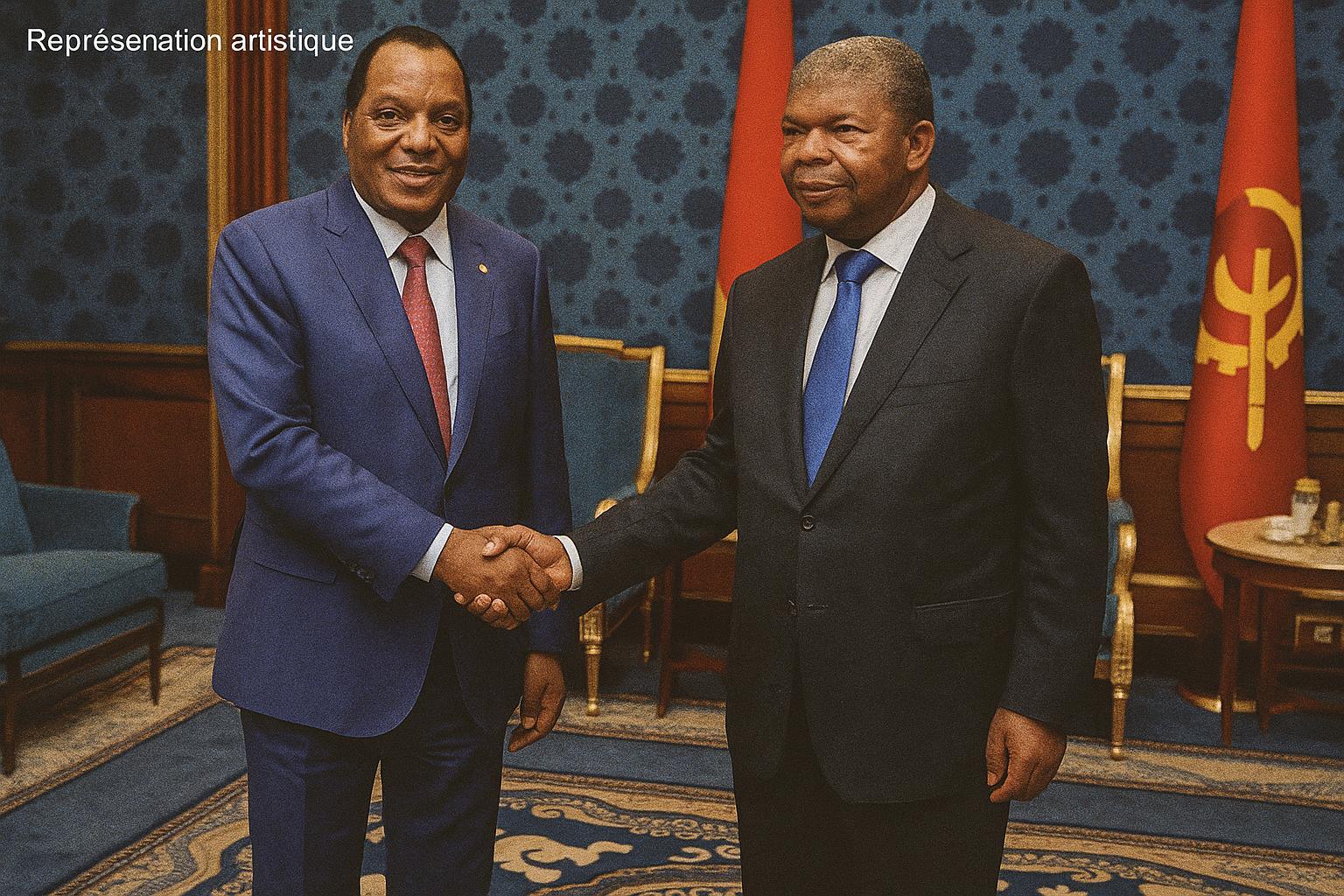Diplomatie congolaise en mouvement
En prenant la décision d’envoyer à Luanda son ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, le président Denis Sassou Nguesso a réaffirmé une tradition congolaise : celle d’une diplomatie d’influence fondée sur la circulation permanente des élites. L’étape angolaise vient couronner un semestre marqué par une intensification des consultations régionales autour de la crise persistante à l’est de la République démocratique du Congo et de la réforme institutionnelle de l’Union africaine.
Pour le chef de la diplomatie congolaise, il s’agissait de faire plus qu’un simple exercice protocolaire. Derrière l’apparente routine d’un déplacement ministériel se lit la volonté de positionner Brazzaville comme un partenaire incontournable dans la recherche de consensus africains, à un moment où le continent redéfinit ses mécanismes de sécurité collective et ses priorités de développement.
Luanda, carrefour stratégique pour l’Afrique centrale
Depuis son accession à la présidence en 2017, João Lourenço a transformé Luanda en plate-forme diplomatique régionale. Les médiations qu’il conduit sur la scène congolaise sont perçues, y compris par les chancelleries occidentales, comme l’expression d’une nouvelle stature angolaise. En venant saluer ce leadership, Brazzaville reconnaît le rôle stabilisateur que peut jouer l’Angola au moment où l’Union africaine, présidée par le chef d’État angolais, revendique des initiatives plus affirmées en matière de prévention des conflits.
Le choix de la capitale angolaise n’est donc pas un simple effet de voisinage. C’est la reconnaissance d’une centralité politique qui dépasse désormais la seule sphère lusophone. Luanda est devenue, selon un diplomate européen en poste dans la région, « l’un des rares espaces où les agendas francophones, anglophones et lusophones se croisent sans crispation ». Conforter ce rôle profite autant au Congo qu’à l’ensemble du bassin du Congo.
Matoko, une candidature africaine à l’Unesco
Au cœur de la visite, la présentation de Firmin Édouard Matoko comme candidat au poste de directeur général de l’Unesco s’inscrit dans une stratégie de représentation africaine accrue au sein des organisations onusiennes. Ancien sous-directeur général chargé de la priorité Afrique à l’Unesco, Matoko symbolise une technocratie continentale rompue aux négociations multilatérales. Sa trajectoire, jalonnée par l’animation de la Biennale de la Culture de la paix à Luanda en 2019, atteste de sa capacité à fédérer des partenaires aux intérêts parfois divergents.
En soulignant que l’Angola soutient officiellement cette candidature, Jean-Claude Gakosso obtient un signal politique fort. Il confère à Matoko une dimension panafricaine susceptible de peser dans les équilibres complexes d’une élection onusienne, où le vote groupé du continent reste un atout décisif.
Une convergence d’intérêts bilatéraux
Le dossier Unesco n’est qu’un volet d’une coopération plus vaste. Le ministre congolais a rappelé que les deux pays partagent plus de 2 500 kilomètres de frontière terrestre et fluviale, un gisement énergétique complémentaire et une ambition commune de diversification économique. Brazzaville mise, entre autres, sur l’expertise angolaise dans la valorisation du gaz associé pour accélérer sa propre transition vers les énergies propres.
Sur le plan de la sécurité, les armées des deux États multiplient les exercices conjoints le long de la frontière afin de contenir les flux transfrontaliers illicites et de prévenir toute extension de l’instabilité venant de la RDC. Cette dimension sécuritaire explique la densité des échanges ministériels et le maintien d’un dialogue direct entre les chefs d’État, perçu comme un facteur de résilience régionale.
Perspective historique des liens Congo-Angola
Si l’année 2025 marquera le cinquantenaire de l’indépendance angolaise, l’histoire croisée des deux pays est bien plus ancienne. Des résistances anti-coloniales aux solidarités de la guerre froide, Brazzaville et Luanda ont souvent fait cause commune. La capitale congolaise fut, dans les années 1960, un foyer diplomatique majeur de soutien aux mouvements de libération portugais. Cette mémoire partagée fonde aujourd’hui une relation empreinte de respect mutuel, où la dimension symbolique soutient des intérêts économiques tangibles.
Le rappel de ce passé, soigneusement entretenu par les deux diplomaties, projette une continuité qui légitime l’intensité actuelle des échanges. Comme le souligne un universitaire angolais spécialiste des relations internationales, « les anniversaires ne sont pas de simples commémorations, ils sont des accélérateurs d’agenda ».
Enjeux géopolitiques régionaux et multilatéraux
La visite a également permis de préparer deux rendez-vous majeurs : la session Amérique-Afrique, tenue pour renforcer les synergies économiques transatlantiques, et le prochain sommet Union africaine-Union européenne, où la voix conjointe de Brazzaville et de Luanda portera sur la réforme du financement du maintien de la paix. Dans ces enceintes, la complémentarité des positions congolaises et angolaises devrait faciliter l’élaboration de propositions africaines cohérentes, notamment sur la sécurisation des corridors logistiques et l’accès équitable aux vaccins de nouvelle génération.
À un moment où la diplomatie se jauge à la capacité de créer des coalitions flexibles, l’axe Brazzaville-Luanda apparaît comme un laboratoire de soft power. L’issue de la candidature Matoko servira de baromètre : elle dira si cette synergie bilatérale peut, au-delà des déclarations, se traduire par des résultats concrets sur la scène multilatérale.