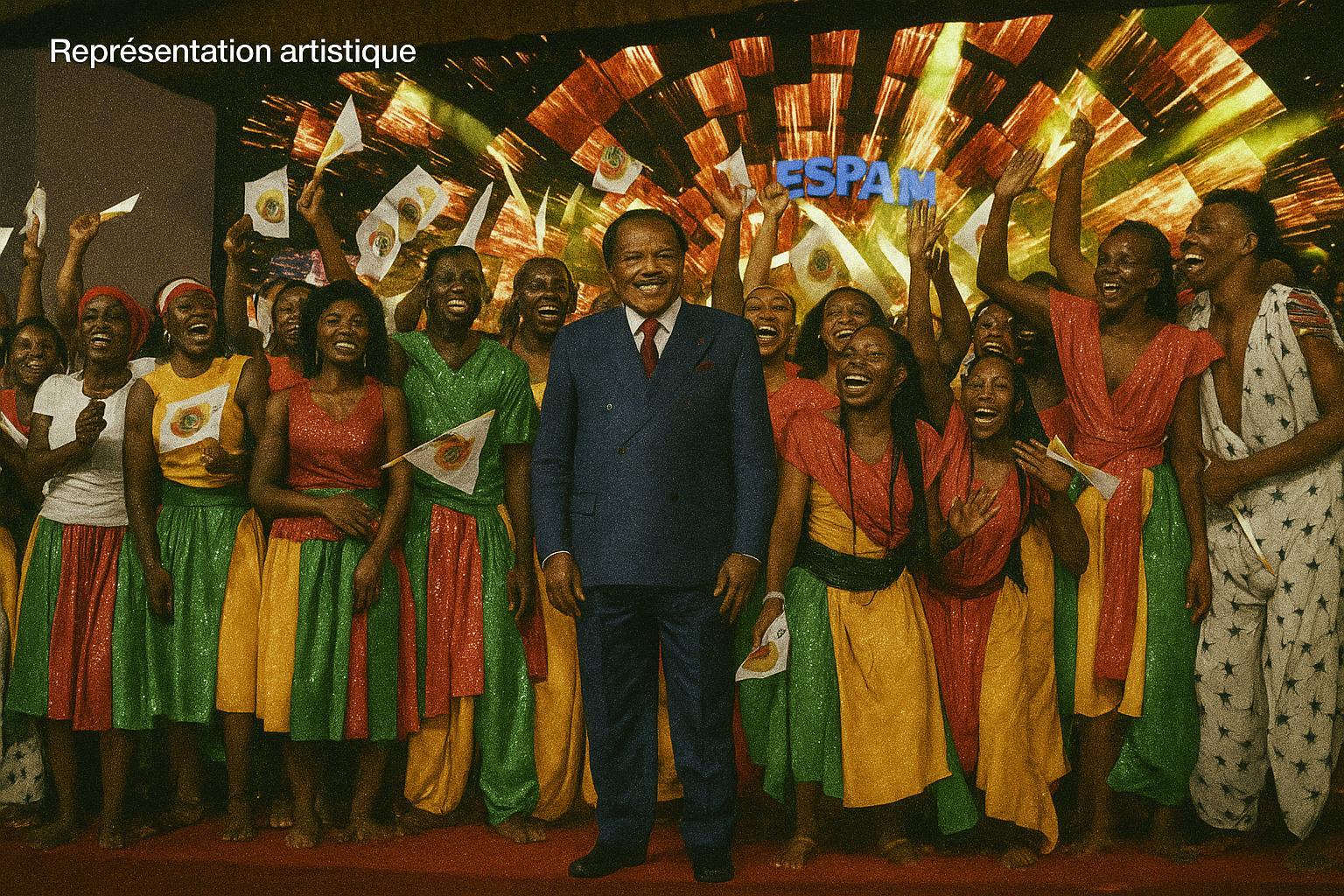Brazzaville au diapason culturel continental
Sous les lambris feutrés du Palais des congrès, la proclamation solennelle du chef de l’État, Denis Sassou Nguesso, a offert à la douzième édition du Festival panafricain de musique un prélude de solennité rare. Le choix d’un format condensé, imposé par les impératifs de calendrier international, n’a nullement amoindri la portée symbolique de l’événement. À l’instant où l’orchestre d’ouverture a entonné ses premières harmonies, la ville capitale a renoué avec un récit qui la situe, depuis 1996, à la croisée des imaginaires sonores du continent. Le Fespam, longtemps perçu comme vitrine patrimoniale, s’inscrit désormais dans une logique d’intégration économique qui transcende le simple divertissement pour revêtir les atours d’un instrument de diplomatie culturelle.
Une inauguration à forte charge symbolique
La présence conjointe de la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, et de la représentante résidente de l’organisation, Fatoumata Barry Marega, a conféré à la cérémonie un retentissement multilatéral. « La musique demeure un trait d’union des peuples et un levier de développement durable », a rappelé Mme Azoulay dans une déclaration applaudie, insistant sur la nécessité de conjuguer sauvegarde des expressions locales et conquête de nouveaux marchés numériques. Les salutations protocolaires du maire Dieudonné Bantsimba, du commissaire général Hugues Gervais Ondaye et de la ministre Marie-France Lydie Hélène Pongault ont tour à tour souligné la constance de l’engagement présidentiel en faveur de la culture comme facteur de cohésion nationale. En filigrane, l’ouverture officielle réaffirme la stratégie congolaise : inscrire la création artistique dans la dynamique de diversification économique engagée par le gouvernement.
Fespam 2025, laboratoire de l’intégration économique
Le thème choisi, « Musique et enjeux économiques en Afrique à l’ère du numérique », illustre la prise de conscience des décideurs face à la mutation des chaînes de valeur culturelles. Quatorze délégations – du Sénégal au Venezuela en passant par la RDC – explorent Brazzaville comme place-tournante d’un marché où streaming, droits voisins et partenariats transfrontaliers redéfinissent la rentabilité de la création. Selon les données du rapport 2024 de l’Union africaine sur les industries culturelles, le secteur musical continental pourrait générer plus de six milliards de dollars annuels d’ici 2030, pour peu que les États investissent dans la formation et l’infrastructure numérique. Dans cette perspective, le Fespam se présente comme un incubateur à ciel ouvert, capable d’amorcer alliances entre labels, plateformes et start-up locales spécialisées dans la régie numérique.
Numérique et industries créatives, vecteurs d’émergence
La table ronde inaugurale, animée par des chercheurs de l’Université Marien-Ngouabi et des entrepreneurs de la French Tech Africa, a mis en avant la nécessité d’une gouvernance des données musicales. L’enjeu n’est plus seulement la maîtrise de la scène, mais celle des algorithmes de distribution et des contrats d’agrégation. Le ministre des Postes et de l’Économie numérique a rappelé, à cette occasion, que le Congo-Brazzaville déploie un backbone fibre optique de plus de 6 000 km, infrastructure clé pour la diffusion en temps réel des concerts programmés à Mayanga et Kintélé. Cette politique technique, arrimée au Plan national de développement 2022-2026, entend positionner le pays comme hub logistique pour les flux culturels d’Afrique centrale, tout en créant des emplois qualifiés pour une jeunesse à forte appétence digitale.
Dialogue des identités et diplomatie douce
Au-delà des recettes et des métriques, la scène du Fespam reste un espace de médiation symbolique. Les pas de rumba kinoise se mêlant aux tonalités sahéliennes du kora rappellent qu’aucune frontière administrative ne résiste durablement aux mouvements esthétiques. Le musicologue camerounais Achille Ekambi souligne que « le festival actualise l’utopie panafricaine des pères fondateurs en la traduisant dans un langage sensible que partagent toutes les générations ». Ce soft power, discrètement mobilisé par Brazzaville, renforce la visibilité internationale du Congo et accompagne les négociations régionales sur la Zone de libre-échange continentale, où les biens culturels bénéficient désormais d’un traitement tarifaire préférentiel.
Enjeux géopolitiques et cohésion nationale
La tenue de l’événement dans un contexte sous-régional marqué par des recompositions politiques confère à la fête des enjeux de stabilité. En offrant une tribune à des artistes venus du Tchad ou du Mali, Brazzaville promeut un récit d’unité qui contraste avec les récits de fragmentation. Sur le plan intérieur, la semaine musicale agit comme catharsis collective : des quartiers populaires de Poto-Poto aux parcs de Kintélé, les foules se réapproprient l’espace public dans un climat de convivialité. Les forces de sécurité, déployées avec discrétion, illustrent la volonté de garantir l’expression culturelle tout en préservant l’ordre républicain. Ce maillage logistique, testé lors des Jeux africains de 2015, fait aujourd’hui figure de modèle dans la région.
Perspectives post-festival pour la Cité capitale
À l’issue des concerts, séminaires et master-classes, l’administration congolaise ambitionne de capitaliser sur l’élan du Fespam pour lancer un fonds d’investissement dédié aux industries musicales. Selon les informations recueillies auprès du ministère de l’Industrie culturelle, ce véhicule financier, adossé à la Banque de développement des États d’Afrique centrale, ciblera la production, la formation et l’export des talents. Parallèlement, un plan de résidence d’artistes à Kintélé devrait consolider l’image de Brazzaville en « capitale créative » inscrite sur la Carte mondiale de l’Unesco des villes de musique. En refermant le programme, Denis Sassou Nguesso a salué « la promesse d’une Afrique qui compose son futur à plusieurs voix », laissant entendre que le festival n’est pas seulement un événement annuel, mais une matrice de politiques publiques visant à ancrer l’économie culturelle dans la trajectoire de l’émergence congolaise.