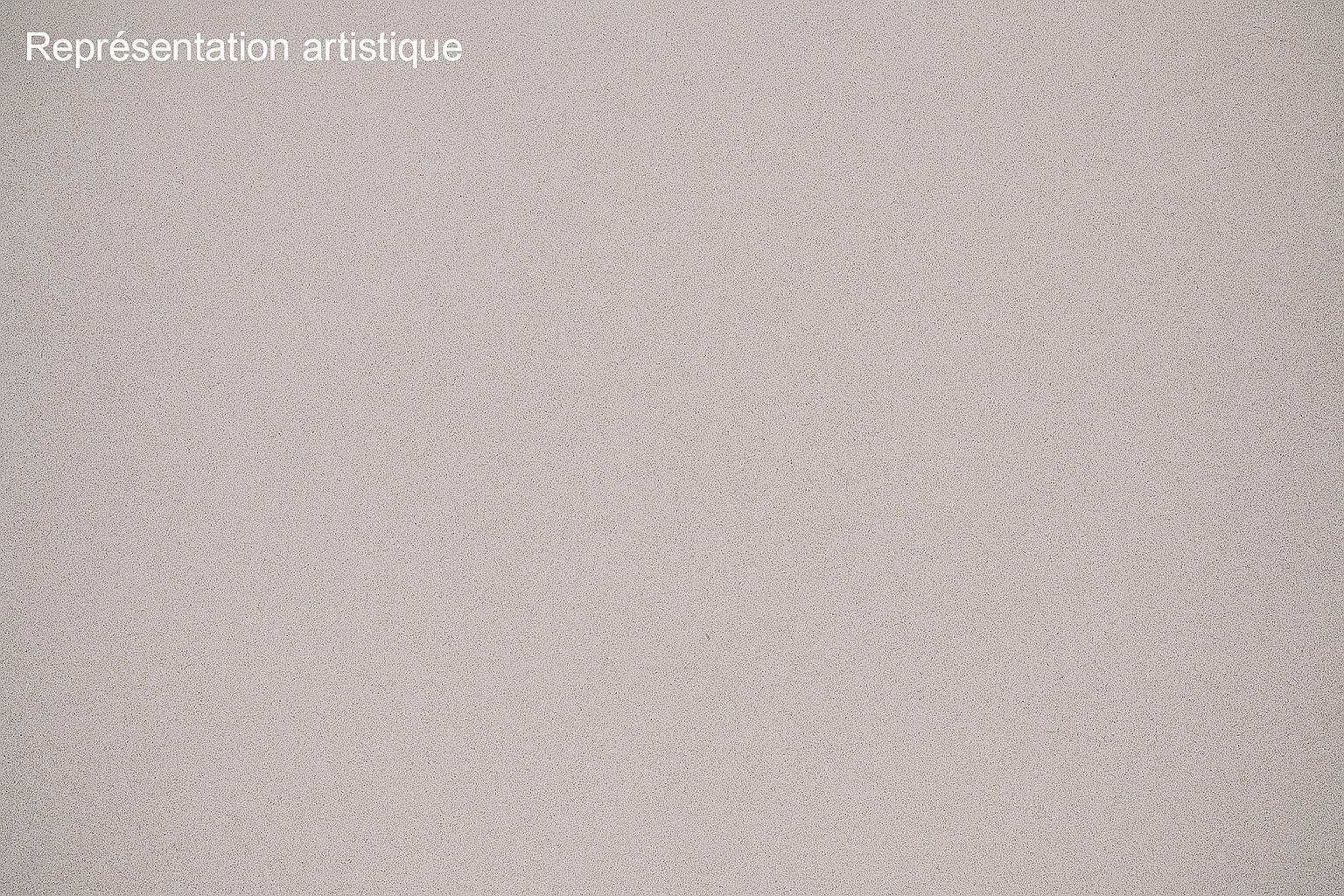Brazzaville accorde la première note
La capitale congolaise s’apprête à renouer avec l’effervescence artistique du Festival Panafricain de Musique. La date du 12 juillet 2025, confirmée par le ministre de la Communication Thierry Lézin Moungalla, résonne comme une réponse à celles et ceux qui redoutaient un report, voire une annulation, au regard de la conjoncture budgétaire. Dans son compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a souligné « la détermination des pouvoirs publics à préserver cette grande manifestation culturelle et artistique dédiée à la jeunesse africaine et congolaise, dans un format adapté à la conjoncture ». L’allocution traduit la volonté de l’exécutif de faire primer la continuité culturelle, tout en intégrant les contraintes macroéconomiques du moment.
L’économie au diapason de la culture
Placée sous le thème « Musique et enjeux économiques en Afrique à l’ère du numérique », la 12ᵉ édition du FESPAM entend rappeler qu’un festival n’est pas seulement un instant festif ; c’est aussi un dispositif de production de valeur. Les études récentes de la Banque africaine de développement évaluent à plus de 4 % la contribution des industries culturelles au PIB de plusieurs économies du continent. En maintenant l’événement, Brazzaville entend capitaliser sur ces externalités positives : dynamisation de la filière hôtelière, mobilisation de prestataires locaux et stimulation de l’entrepreneuriat culturel. Dans les allées du marché de la musique africaine prévu au programme, labels indépendants, start-up et investisseurs croiseront leurs agendas, confirmant l’intuition que la musique est, pour le Congo comme pour ses partenaires, bien davantage qu’un divertissement.
Le numérique, accélérateur d’inclusion
L’articulation avec le numérique ne relève pas de l’effet de mode. Sur une scène africaine où les plateformes de streaming grignotent chaque jour des parts de marché, la question de la monétisation équitable des œuvres devient centrale. Des tables rondes explorant la blockchain pour la rémunération des droits voisins aux ateliers sur la data-analyse pour cibler des publics de niche, le festival se place sous le signe d’une modernité pragmatique. « La transformation digitale n’est pas une option mais un impératif », confie une conseillère du ministère des Postes et Télécommunications, soulignant que la couverture 4G du pays dépasse désormais 90 % des zones urbaines. Pour les artistes congolais, l’enjeu est double : conquérir des audiences internationales et structurer un écosystème local de production inscrit dans les standards mondiaux.
Un festival comme soft power régional
Créé en 1996 sous l’égide de l’Union africaine, le FESPAM se présente depuis son origine comme un instrument de diplomatie culturelle. À chaque édition, délégations ministérielles, représentants d’organisations panafricaines et opérateurs privés convergent vers Brazzaville. Le maintien de l’événement en 2025, malgré un resserrement budgétaire, contribue à consolider cette position de hub culturel d’Afrique centrale que revendique le Congo. L’impact symbolique dépasse la simple célébration musicale : il s’agit d’affirmer la capacité de l’État à honorer ses engagements internationaux et à faire de la culture un pilier de son rayonnement. Plusieurs chancelleries, dont celles d’Afrique australe et du Maghreb, envisagent déjà des pavillons nationaux qui témoigneront de la pluralité des paysages sonores africains.
De la rumba au patrimoine durable
La projection annoncée d’un documentaire consacré à la rumba congolaise – inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO – rappelle combien le FESPAM s’inscrit dans une longue trame historique. En choisissant de célébrer cette musique, le festival assume le rôle de gardien d’une mémoire partagée, tout en l’ancrant dans les débats contemporains sur le développement durable. Les artisans luthiers, exposés dès l’ouverture, illustreront la transmission intergénérationnelle des savoir-faire. Au-delà des représentations scéniques, le comité d’organisation travaille à un dispositif d’archives numériques capable de documenter et de diffuser, à l’échelle mondiale, les performances captées. C’est là un exemple de « patrimonialisation active », concept cher aux sociologues de la culture, qui envisage la conservation non pas comme une mise sous cloche, mais comme un processus dynamique, vecteur d’innovation.
Cap sur juillet 2025
À moins d’un an de l’ouverture, la logistique avance à un rythme calibré : finalisation des partenariats avec les transporteurs, sécurisation des sites de spectacle et consolidation des protocoles sanitaires. Les autorités entendent conjuguer attractivité touristique et sécurité publique, éléments essentiels pour convaincre un public international exigeant. Dans les coulisses, un comité inter-ministériel coordonne les lignes budgétaires afin de contenir les dépenses tout en préservant la qualité de l’accueil. Ce délicat exercice d’équilibre budgétaire, applaudi par plusieurs observateurs économiques régionaux, démontre qu’il est possible de concilier rigueur financière et ambition culturelle.
Vers une diplomatie culturelle renouvelée
En définitive, le maintien du FESPAM 2025 illustre la stratégie de Brazzaville : faire de la culture un vecteur d’image et de croissance, même dans un contexte économique exigeant. En adoptant un format « adapté », l’exécutif s’autorise la flexibilité nécessaire tout en préservant l’essence du festival. Tandis que les artistes affûtent leurs partitions et que les organisateurs peaufinent le dernier kilomètre logistique, la capitale congolaise se prépare à vibrer au rythme d’un soft power musical dont l’écho pourrait dépasser les rives du fleuve Congo. Aux yeux des diplomates comme des investisseurs, juillet 2025 constituera un baromètre : celui de la capacité d’un État à convertir la contrainte en opportunité, et à inscrire la musique au cœur d’un projet de société tourné vers l’avenir.