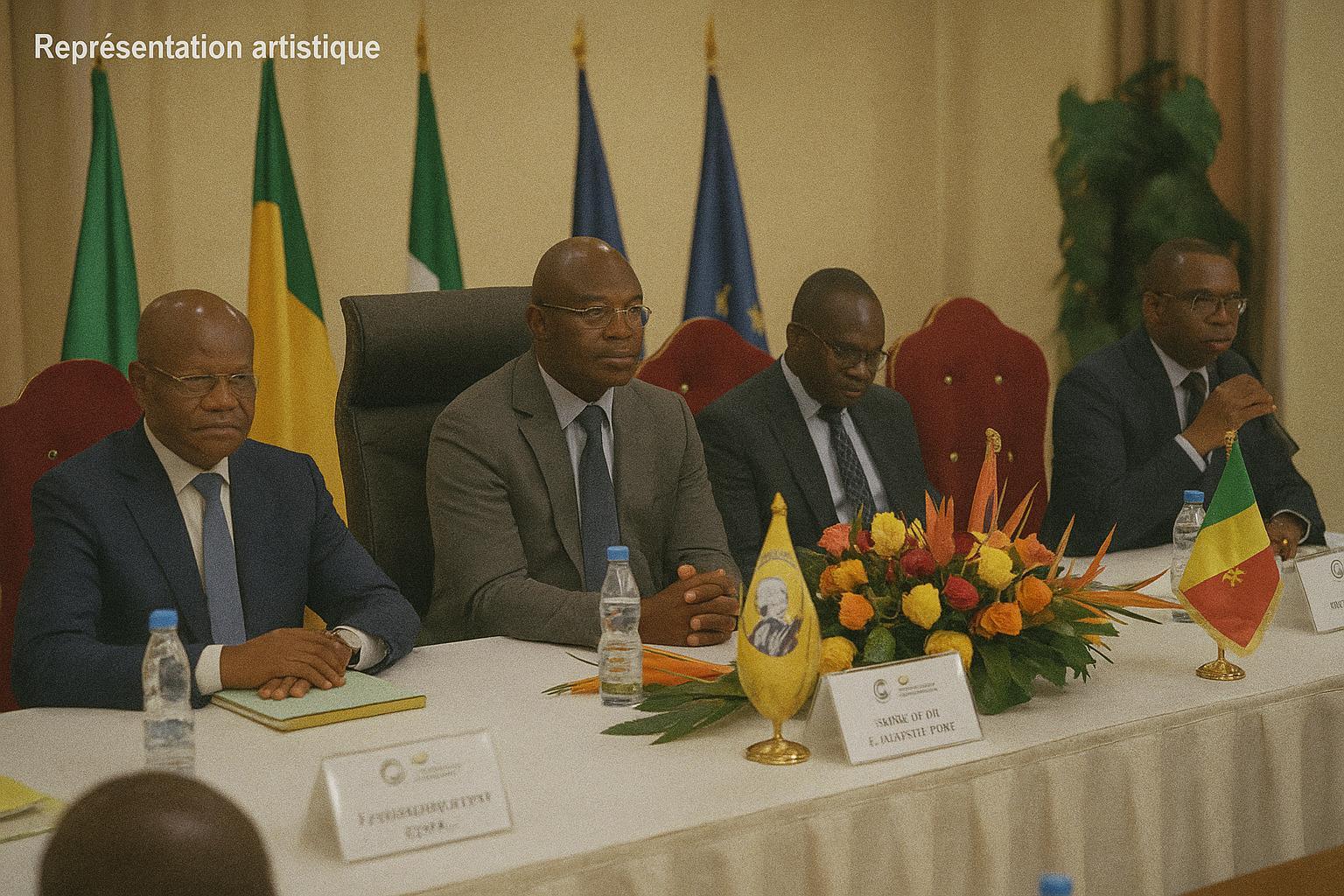Une coopération régionale à l’épreuve des chiffres
À l’ombre des flamboyants qui jalonnent l’avenue de la Base, à Brazzaville, les experts des six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale se sont donné rendez-vous pour un exercice aussi discret qu’essentiel : bâtir un langage commun de la donnée agricole. Financée par la Banque mondiale, la rencontre marque une étape clef du Programme statistique 2021-2030 de la Cémac, lui-même arrimé à la Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique portée par l’Union africaine.
Derrière la technicité apparente des débats, l’enjeu est politique : doter la sous-région d’un socle d’indicateurs comparables afin de piloter la sécurité alimentaire, orienter l’investissement et mesurer la contribution réelle de l’agriculture au produit intérieur brut régional. « Nous devons passer d’une juxtaposition d’estimations nationales à un cadre intégré de production de preuves », insiste Nicolas Beyeme-Nguema, commissaire en charge des politiques économiques à la Commission de la Cémac.
Des défis institutionnels encore patents
Le chantier, toutefois, ne relève pas du simple ajustement technique. Différences de calendriers agricoles, hétérogénéité des nomenclatures de cultures, outils informatiques parfois obsolètes : les obstacles, identifiés par les participants, traduisent les trajectoires diverses des instituts nationaux de la statistique. Au Tchad ou en Centrafrique, la faible densité des réseaux administratifs complique la collecte, tandis qu’au Gabon ou en Guinée équatoriale, la question principale demeure la formation d’enquêteurs capables de maîtriser les standards internationaux.
Les experts réunis à Brazzaville s’accordent néanmoins sur un principe : privilégier une approche participative. Chaque institut national est invité à présenter ses forces et ses besoins, afin de mettre en place un dispositif de renforcement capacitaire différencié. « Harmoniser ne signifie pas uniformiser », résume un participant camerounais, rappelant que la cohérence méthodologique doit s’accompagner d’une flexibilité adaptée à la mosaïque agro-écologique de la sous-région.
Le Congo-Brazzaville en éclaireur méthodologique
Hôte de l’atelier, le Congo-Brazzaville se positionne en catalyseur. Pour le directeur général de l’Institut national de la statistique, Dr Stève Bertrand Mboko Ibara, l’enjeu est de « faire émerger une culture régionale du chiffre », condition sine qua non de l’intégration communautaire. Le pays, qui a récemment modernisé son système d’information agricole grâce à une plateforme numérique de géoréférencement des exploitations, met ainsi à disposition son retour d’expérience.
Le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, Paul Valentin Ngobo, souligne pour sa part que la normalisation statistique permettra de mieux capter la valeur ajoutée des filières manioc, maïs et élevage, prioritaires dans le Plan national de développement. « Les chiffres harmonisés offriront une lecture sans distorsion des échanges intracommunautaires », déclare-t-il, plaidant pour une transparence accrue des flux afin de stimuler le commerce régional.
Un levier pour la souveraineté alimentaire
L’agriculture, rappelons-le, représente près de 20 % du PIB agrégé de la Cémac, mais son potentiel demeure sous-exploité, notamment en raison d’un déficit d’investissements calibrés. En dotant la région d’indicateurs robustes – rendement moyen par culture, accès aux intrants, volumes commercialisés – les décideurs espèrent mieux cibler les subventions, rationaliser les infrastructures de stockage et anticiper les crises climatiques.
Pour la Banque mondiale, qui accompagne financièrement l’initiative, la disponibilité de données homogènes constitue un prérequis à toute stratégie de résilience. Le climat sahélien du Tchad, la forêt équatoriale du Congo ou les plateaux fertiles du Cameroun imposent des réponses différenciées qu’un système statistique harmonisé doit pouvoir objectiver sans biaiser les comparaisons.
Le pari de la comparabilité internationale
Au-delà de la zone Cémac, l’alignement sur les standards de la Commission de statistique des Nations unies facilitera l’intégration des indicateurs régionaux dans les bases de données mondiales, qu’il s’agisse de la FAO ou de l’OCDE. Les investisseurs privés, friands de benchmarks fiables, disposeront ainsi d’outils pour évaluer le risque et planifier des partenariats agro-industriels.
La fenêtre d’opportunité est étroite : le cadre continental d’harmonisation couvre la période 2017-2026. Les participants à l’atelier de Brazzaville le savent : la crédibilité de la parole africaine dans les fora internationaux dépendra de la capacité du continent à parler la grammaire universelle des statistiques. Pour l’heure, le consensus semble acquis ; reste à transformer la promesse méthodologique en pratiques quotidiennes dans les zones rurales de la Cémac.
Lorsque, d’ici quelques années, les chiffres consolideront la part réelle du secteur agricole dans les exportations non pétrolières et mesureront avec précision les gains de productivité, la décision publique y gagnera en lisibilité. La gouvernance, quant à elle, s’appuiera sur un instrument d’objectivation susceptible de nourrir un dialogue apaisé entre les États membres, renforçant ainsi la dynamique d’intégration prônée par les chefs d’État.