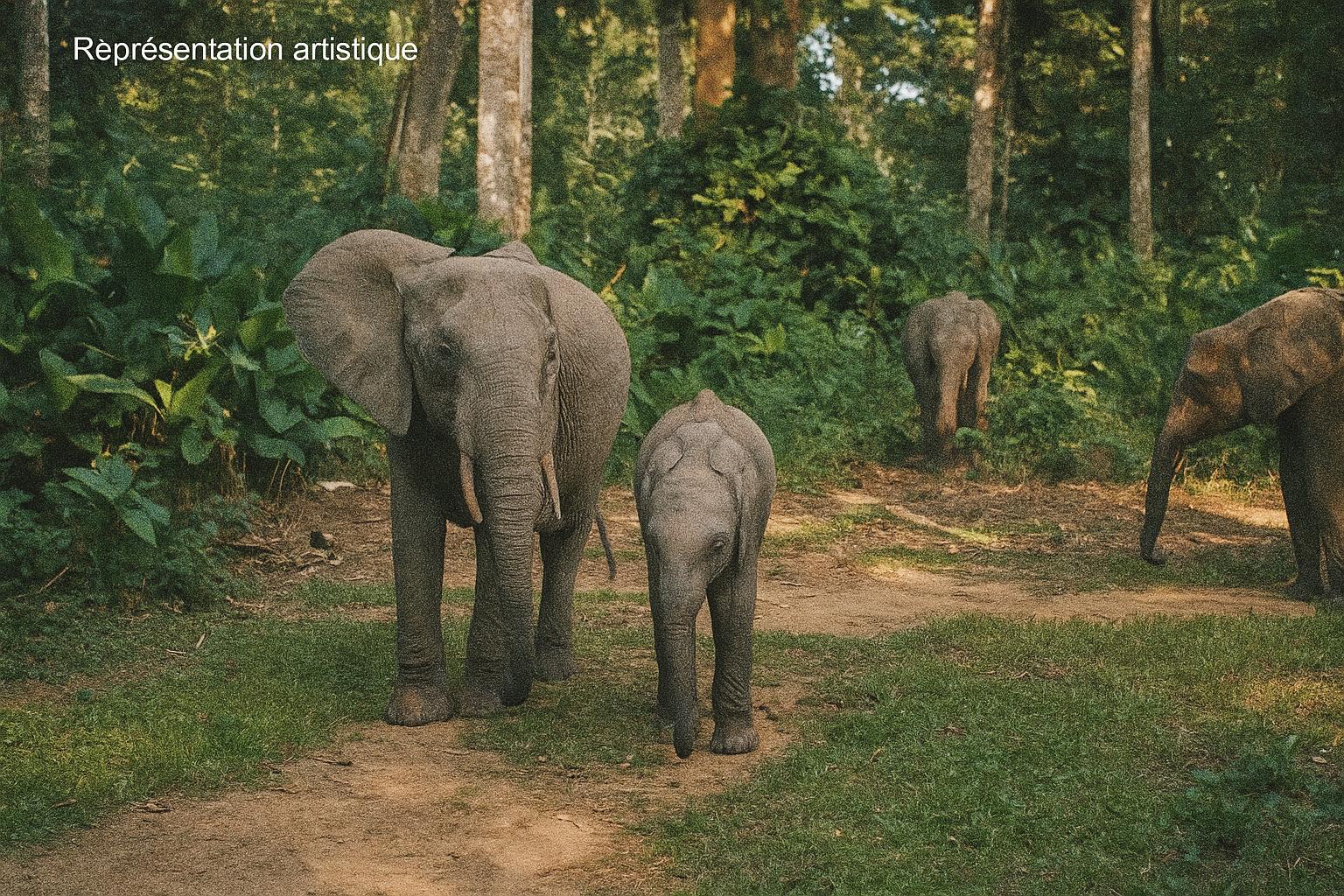Patrimoine forestier et diplomatie climatique
À l’heure où la préservation des massifs tropicaux du Bassin du Congo s’impose comme un axe majeur de la diplomatie climatique, l’annonce, le 7 juillet 2025, de l’élaboration du plan d’aménagement du parc national Ntokou-Pikounda fait figure de pas décisif. Située à cheval sur les départements de la Cuvette et de la Sangha, cette aire protégée de plus de quatre mille kilomètres carrés abrite un continuum forestier rare, des populations de gorilles occidentaux et de céphalophes mengeant dans des clairières à marécages, mais aussi des villages bantous et autochtones dont les pratiques de subsistance demeurent intrinsèquement liées à la forêt et aux eaux fluviales. Pour Brazzaville, souvent saluée pour sa participation aux initiatives internationales telles que la Commission climat du Bassin du Congo, cet agenda concilie impératif environnemental et stabilité sociale.
Un signal convergent venu de Gland et de Brazzaville
Le Fonds mondial pour la nature, dont le siège se trouve à Gland, en Suisse, a publié un appel à consultation fixant soixante-dix jours de terrain aux experts chargés de rédiger la matrice d’aménagement. Le gouvernement congolais, garant ultime de la souveraineté sur les ressources, a confirmé son appui logistique et institutionnel. Cette conjonction d’acteurs publics et non gouvernementaux répond à plusieurs années de plaidoyer conduit par le Centre d’actions pour le développement, organisation congolaise qui a documenté, depuis 2022, les difficultés d’accès aux ressources traditionnelles et le flou persistant entourant la délimitation juridique du parc. Dans un communiqué daté du 9 juillet 2025, le C.a.d salue « une avancée qui confirme l’engagement de l’État à concilier préservation de la nature et droits fondamentaux ».
Calendrier resserré, gouvernance partagée
Le cahier des charges, négocié avec les ministères compétents, prévoit un diagnostic participatif, l’intégration de cartes socio-territoriales et la consolidation d’un cadre règlementaire unique avant la fin de l’année 2025. L’ambition est double : clarifier les limites spatiales du parc afin de sécuriser les investissements dans le tourisme scientifique, et codifier des mécanismes de partage des bénéfices issus du carbone forestier ou du paiement pour services écosystémiques. Au-delà de ces considérations économiques, la méthode fait la part belle à la gouvernance inclusive ; elle mise sur des comités locaux où chefs traditionnels, représentants de la fonction publique et techniciens de la conservation disposeront d’une voix délibérative équivalente. Dans les couloirs du ministère de l’Économie forestière, on rappelle que ce schéma répond aux principes actés par la Loi 33-2022 sur la décentralisation verte, adoptée à l’unanimité par le Parlement.
La rivière Bokiba, cœur battant des attentes sociales
Symbole d’un enjeu vital, la rivière Bokiba traverse la zone nord du parc et nourrit poissons, cultures vivrières et déplacements communautaires. L’accès à ce cours d’eau a fait l’objet, ces dernières années, de restrictions temporaires liées à la lutte contre la pêche illégale. Elles ont suscité des crispations, amplifiées par la difficulté d’acheminer des produits de première nécessité vers Makoua ou Ouesso. Les discussions en cours prévoient la définition de couloirs écologiques navigables et la levée graduelle des limitations dès que des dispositifs de suivi participatif — incluant l’auto-contrôle par les piroguiers eux-mêmes — seront opérationnels. Selon le chef traditionnel Balisombo, interrogé par nos soins, « l’eau ne doit pas diviser, elle doit relier ; si les règles sont claires, nous serons les premiers à protéger notre rivière ».
Une convergence d’intérêts pour 2025
La fenêtre temporelle fixée à cinq mois traduit la volonté de capitaliser sur l’élan politique suscité par la tenue à Brazzaville, en décembre prochain, du Sommet des trois Bassins forestiers. Les bailleurs multilatéraux ont déjà signalé que la qualité du plan d’aménagement de Ntokou-Pikounda servira d’indicateur structurant pour l’accès à de nouveaux financements climatiques. Pour le Congo-Brazzaville, engagé dans la diversification de son économie, la valorisation durable de ce capital naturel représente un vecteur de croissance et de rayonnement diplomatique. Les observateurs s’accordent à dire que la réussite du processus dépendra de la traduction, sur le terrain, des recommandations relatives à la sécurisation foncière et à l’inclusion des femmes dans les instances locales.
Conservation inclusive, responsabilité partagée
Si le C.a.d se montre vigilant, l’organisation affirme percevoir dans la dynamique actuelle une opportunité sans précédent de co-construction. WWF, de son côté, insiste sur la dimension expérimentale du modèle participatif qu’il conviendra de documenter et de répliquer. Quant aux autorités congolaises, elles soulignent que l’exercice témoigne de la maturité institutionnelle du pays, capable d’intégrer société civile et partenaires techniques dans la gestion de ses réserves stratégiques. En filigrane, le succès attendu de Ntokou-Pikounda pourrait devenir la matrice d’une nouvelle génération d’aires protégées, à la fois rempart contre les émissions mondiales de carbone et catalyseur de prospérité locale. La route est courte mais exigeante ; elle suppose de conjuguer rigueur scientifique, écoute sociale et vision politique. À un semestre de l’échéance, la partition semble écrite. Reste désormais à l’interpréter avec justesse pour offrir, au cœur des forêts congolaises, la preuve tangible qu’écologie et développement peuvent être plus qu’un slogan : un pacte durable.