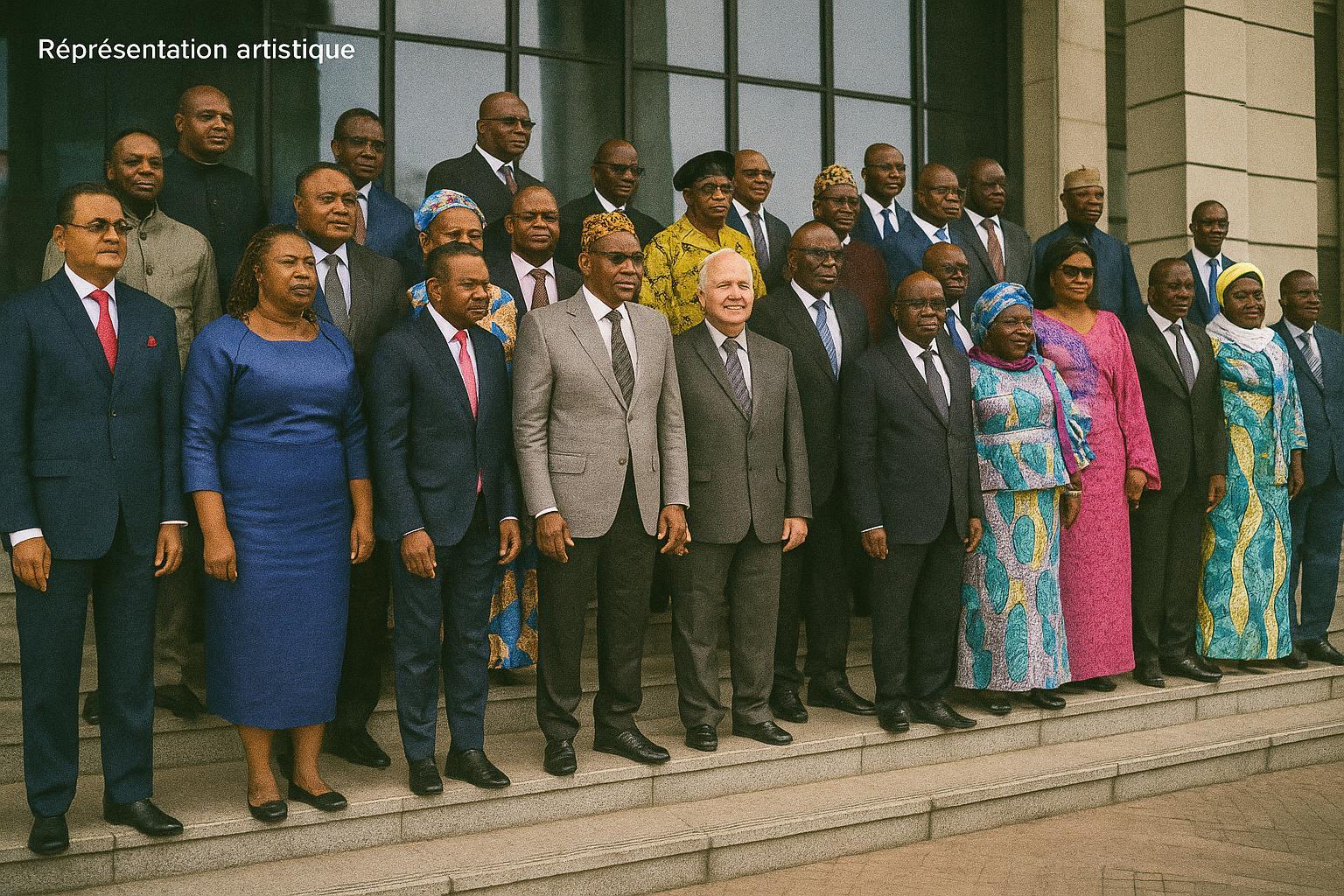L’enjeu stratégique de la décentralisation
Au cœur du processus de modernisation institutionnelle engagé depuis le début des années 2000, la décentralisation constitue désormais un axe structurant du projet national de développement économique et social. En choisissant de former ses élus sur ce thème, le groupe parlementaire Parti congolais du travail (PCT) et alliés rappelle que le Sénat est, par vocation constitutionnelle, la Chambre des collectivités territoriales. L’initiative intervient dans un contexte où plusieurs conseils départementaux se plaignent encore d’un déficit d’ingénierie administrative et financière, alors même que les textes de 2011 et de 2017 encadrant la décentralisation reconnaissent à ces entités un rôle accru dans l’allocation des investissements publics. Pour les diplomates en poste à Brazzaville, la manœuvre traduit une volonté de consolider la stabilité institutionnelle en intégrant davantage les territoires à la décision centrale.
Un atelier au timing politique raffiné
Réunis les 17 et 18 juillet dans l’hémicycle provisoire du Palais des congrès, les sénateurs de la majorité présidentielle se sont vu proposer un véritable séminaire de perfectionnement. Sous la houlette de Théophile Adoua, président du groupe PCT et alliés, le programme a été calibré pour répondre aux préoccupations que ces élus expriment régulièrement lors des séances de contrôle : articulation entre compétences transférées et ressources affectées, efficacité du contrôle budgétaire, mais aussi appropriation citoyenne des réformes. En pleine session parlementaire, l’organisation d’un tel atelier illustre la dynamique d’auto-formation de la majorité, perçue par plusieurs observateurs comme un gage de maturité institutionnelle plutôt qu’un simple exercice de communication (analystes parlementaires).
L’expertise comparée : la leçon française
Invité inaugural, Jean Giraldon, professeur de droit public à la Sorbonne, a proposé une grille de lecture fondée sur l’expérience française. « La proximité décisionnelle constitue la meilleure assurance de légitimité », a-t-il rappelé, avant de détailler l’évolution hexagonale du couple commune-intercommunalité. Si les sénateurs ont salué la richesse de la comparaison, ils n’ont pas manqué de souligner les spécificités congolaises, à commencer par la densité démographique ou la répartition inégale des richesses minières. La séquence a permis de mettre en exergue l’importance de la clause de compétence générale et la nécessité d’un accompagnement financier stable. En toile de fond, l’idée d’adapter sans transposer mécanismes et outils est ressortie comme un leitmotiv, garantissant la compatibilité culturelle et administrative des réformes envisagées.
Le transfert de compétences, cœur du chantier
Le second exposé, conduit par Charles Ngafouomo, haut-commissaire aux Réformes électorales, a décortiqué la mécanique du transfert de compétences. L’expert a mis en lumière les trois conditions de réussite d’un tel processus : clarification normative, évaluation des charges induites et réajustement progressif des dotations. Selon lui, « aucune collectivité ne peut exercer une attribution sans la pleine maîtrise de ses marges de financement ». Les débats ont notamment porté sur la gestion du cadastre et de l’état civil, deux domaines où l’État prépare un désengagement partiel au profit des conseils départementaux. Les sénateurs ont insisté sur la nécessité d’un calendrier réaliste, capable d’éviter un choc institutionnel et de préserver la qualité du service public.
Lecture budgétaire et contrôle parlementaire
La troisième intervention, assurée par Théodore Boutsoki Kombo, spécialiste des finances publiques, a rappelé que le lien financier entre l’État et les collectivités demeure le socle de la décentralisation. Pointant les marges d’amélioration dans l’examen du budget, il a invité les élus à s’approprier les indicateurs de performance, désormais annexés aux lois de finances. L’ouverture d’une rubrique spécifique « Appui aux collectivités » dans le budget 2024 a été saluée comme un signal de confiance envers les chambres parlementaires. Pour le Sénat, qui détient la primauté sur les questions liées au développement local, le contrôle de l’exécution budgétaire devient ainsi un levier d’incitation et d’ajustement, plutôt qu’une simple posture d’évaluation ex post.
Une majorité présidentielle en quête de cohésion
Au-delà des aspects techniques, l’atelier a également renforcé la cohésion interne du groupe majoritaire. Théophile Adoua a souligné qu’un « langage commun sur la décentralisation » est indispensable pour dialoguer efficacement avec le gouvernement et les collectivités. La démarche s’inscrit dans la continuité des consultations menées en 2022 auprès des maires et préfets, lesquelles avaient mis en exergue des divergences d’interprétation sur la portée des textes. En se dotant d’un corpus de références partagées, les sénateurs espèrent fluidifier le processus législatif et accélérer la production de décrets d’application, souvent perçus comme le maillon faible de la réforme.
Perspectives et attentes des territoires
À l’issue des travaux, les participants ont convenu d’instituer un suivi semestriel des avancées, afin de mesurer l’impact réel sur le terrain. Un rapport d’étape sera transmis à la Commission Économie et Finances, puis débattu en séance publique. La société civile, attentive, espère de son côté que cette dynamique parlementaire se traduira par une amélioration tangible des services de base dans les communes rurales, notamment en matière d’adduction d’eau et de cartographie foncière. Pour l’heure, l’atelier illustre la capacité du Sénat à conjuguer formation, concertation et prospective, dans une perspective constructive et fidèle à l’esprit du projet de société porté par le président Denis Sassou Nguesso. Le pari d’une décentralisation maîtrisée semble ainsi engagé, sans précipitation mais avec une détermination régulièrement réaffirmée.